Chapitres précédents:
Les chapitres précédents d’un roman policier sont trop difficiles à résumer. Nous y renvoyons le lecteur: le feuilleton paraît le dimanche et peut être consulté en ligne.
II
Il faut dire qu’un événement s’est produit, juste à ce moment-là, qui m’a fait oublier pas mal de choses de ma vie précédente: j’ai rencontré Rico. Et la manière dont j’ai rencontré Rico, les événements qui sont liés à cette période, ont balayé les incidents somme toute mineurs de ma vie précédente.
Cela a commencé comme une enquête ordinaire. Je rentrais d’un long week-end de cinémas et de musées à Paris.
Je suis arrivée au bureau, et Sophie m’a dit:
«Une dame Clara Varek a appelé trois fois depuis que je suis là.»
«Qu’est-ce qu’elle veut?»
«Elle veut que vous arriviez à l’heure.»
«Sophie, vous n’allez pas recommencer…»
«Ce n’est pas moi qui le dis, c’est elle. Préparez-vous à recevoir un savon. Vous voulez un café? Madame Varek pourrait revenir à la charge avant que vous ne l’ayez bu, mais enfin on peut tenter…»
Elle s’affairait déjà.
Sophie et moi nous entendons très bien, même si elle trouve que, le matin, j’arrive toujours trop tard. J’ai beau lui dire que je travaille souvent le soir, elle hausse les épaules. Elle ne me croit plus depuis le soir où je lui ai dit que je devais consulter mon avocat – ce qui était parfaitement exact. Pierre-François était au champ de foire, il tenait la caisse aux autos tamponneuses. J’ai pris une auto tamponneuse, il a trouvé un remplaçant, est venu s’asseoir près de moi et on a discuté le coup tout en virevoltant sur la piste. Une séance parfaitement claire, productive, utile. Sauf que Sophie nous a vus.
Elle a eu beau constater les résultats dans la correspondance du lendemain. Rien n’y a fait. Maintenant, chaque fois que j’affirme travailler le soir, elle me voit dans une auto tamponneuse.
J’ai réussi à boire mon café avant que Madame Varek ne se manifeste. Elle a rappelé au moment où je mettais la main sur le téléphone pour composer son numéro.
«Marie Machiavelli.»
«Clara Varek. J’espère que vous êtes aussi subtile que votre ancêtre.»
Le briquet en or n’est pas pour toi, ma bonne dame.
«En quoi puis-je vous être utile?»
«C’est à propos du hold-up du train postal.»
«Excusez-moi, Madame, mais je ne vois pas. Quel hold-up? Et quel train postal? En Suisse?»
«Très drôle. En Suisse. Entre Fribourg et Lausanne.»
«Et que puis-je pour vous?»
«Eh bien voilà. Je viens d’être arrière-grand-mère.»
«Je vous félicite.»
«Oui, et j’ai envoyé le hochet familial à ma petite-fille pour son bébé. Une fillette.» Pourquoi me raconte-t-elle ça? La vie de cette dame ne m’intéresse pas. J’étais sur le point de raccrocher. La seule chose qui m’a retenue, c’est que mon agenda était pratiquement vide, et que pour arrondir la fin du mois… J’ai fait un effort:
«Je vois.»
«Ce hochet est en argent, avec un manche en ivoire. Il est irremplaçable, vous comprenez. Je l’ai envoyé il y a huit jours et il n’est pas arrivé. La poste me dit que le paquet était dans le train du hold-up, et la police me dit qu’on ne peut rien faire. Ils me traitent tous comme si j’étais une imbécile, et j’ai la sensation que personne ne cherche.»
«Je vous avoue, chère Madame, que je ne sais pas de quel hold-up vous parlez.»
«Où étiez-vous, ces jours derniers?»
«J’étais à Paris. Je débarque.»
«Lisez les journaux. On n’y parle que de cela. Entre Fribourg et Lausanne, des bandits ont ligoté les facteurs du fourgon postal, ils ont emmené quelques paquets et ont disparu.»
«La police et la Poste doivent être sur les dents.»
«Vous n’avez pas écouté la radio, ce matin? Ils ont dit qu’ils avaient perdu la trace des malfaiteurs.»
J’aurais pu dire à Madame Varek que le matin, moi, à la radio, j’écoute un des programmes qui m’offrent exclusivement de la musique classique, sans «animateurs» au bavardage superflu, et comme des deux stations qui pratiquent cette politique bénie aucune ne fait d’information, il y a peu de chances qu’elles m’aient informée au sujet d’un hold-up de chez nous. Ce matin-là, j’ignorais par conséquent que hold-up il y eût eu.
«Cela ne m’a pas frappée», ai-je répondu à Madame Varek pour résumer. «Et puis la police ne dit pas toujours ce qu’elle fait réellement. Je suis sûre qu’elle est sur les dents. Sans compter qu’elle est autrement outillée que moi.»
«Je croyais que les délinquants, c’était votre métier?»
«Ah! mais pas du tout. Je fais des enquêtes, et si vous pensez que votre hochet a été kidnappé par le Milieu, je vous avertis tout de suite que je ne peux rien pour vous.»
«Vous n’êtes pas accréditée par la police?»
«Disons qu’ils me connaissent. J’ai fréquenté une école de police à New York comme stagiaire étrangère, et ils trouvent ça suffisamment original pour ne pas me fermer la porte au nez. Mais on ne peut pas dire que leur bienveillance aille très loin… Qui vous a donné mon nom, d’ailleurs?»
«Madame Rosalinde Schmidt.»
«Elle voulait récupérer son fils adolescent qui allait faire de la lévitation avec une secte kidnappeuse d’enfants, rien à voir avec des malfaiteurs.»
«Vous l’avez récupéré.»
«Oui, c’est ma spécialité, l’argent et les enfants en cavale.»
«Bon, eh bien, récupérez mon hochet “en cavale”, comme vous dites si joliment.»
«C’est huit cents francs par jour plus les frais, vous êtes sûre que votre hochet les vaut? Pour peu que je n’arrive pas à voir tout le monde en un jour, c’est cher.»
«Ma chère enfant, j’ai plus d’argent qu’il ne m’en faut pour vivre. Et je n’ai qu’un hochet, qui me vient de ma grand-mère. J’ai envie qu’il reste dans la famille.»
Émouvant.
J’ai dit oui. Cela ne me coûterait pas grand-chose. Deux ou trois coups de fil, une visite guidée au westernien train postal et voilà.
Facile, après coup, de dire que j’aurais dû pressentir.
Un hochet.
Même Nostradamus n’y aurait rien vu.
«Dites, Sophie, qu’est-ce que c’est que cette histoire de hold-up du train postal?» ai-je demandé en rinçant ma tasse.
«Rocambolesque.» Sophie était péremptoire. «C’est arrivé mercredi dernier entre neuf heures dix et neuf heures et demie du soir, pendant que le train allait de Fribourg à Lausanne. Quatre bandits masqués, dont l’un au moins parlait italien, ont pris le fourgon postal de l’Intercity, ont ligoté les deux employés de la Poste qui s’y trouvaient et ont passé les paquets au peigne fin. Ils en ont éventré une douzaine qu’ils ont vidés. On pense qu’ils en ont emmené deux ou trois, on ne sait pas précisément lesquels. Il faut dire qu’ils ont raflé aussi, et même principalement, une demi-douzaine de sacs postaux bourrés de courrier. La Poste avoue un à deux millions de pertes, mais ils ne disent jamais tout.»
«Alors si quelqu’un prétend que son paquet n’est pas arrivé, on ne peut pas vérifier?»
«Pas vraiment.»
«Ouais. Pour retrouver le hochet, tintin.»
«Quel hochet?»
Je suis moralement certaine que Sophie écoute la plupart de mes conversations pour peu qu’elle en ait le temps, et que par conséquent elle avait entendu celle que je venais d’avoir avec Madame V., mais comme elle faisait semblant de ne pas savoir, j’ai fait semblant de ne pas la soupçonner. Qui plus est, sa curiosité m’a parfois rendu service, lorsque c’était ma parole contre celle d’un client de mauvaise foi; et comme Sophie est curieuse, mais pas cancanière, cela a fini par m’être égal. J’ai par conséquent expliqué comme si elle ne savait rien, et j’ai conclu:
«Moi, il faut que je m’occupe de Mario Blanc, j’ai rendez-vous dans un quart d’heure. Appelez Madame Varek et demandez-lui une description précise du paquet. Et puis renseignez-vous à la Poste pour savoir qui enquête chez eux, et auprès de la police cantonale vaudoise pour savoir si ce sont eux qui ont pris l’affaire en main. Je n’ai jamais eu à m’occuper de la récupération d’un objet perdu dans un train.»
Et puis la Suisse n’est pas le Mexique. Les scénarios à la John Ford, ce n’est pas notre fort. Une fois, ils ont volé cinq sacs postaux à la gare d’Yverdon, il y a quinze ou vingt ans – on en parle encore. L’autre soir, une vieille dame a été poignardée par un camé (sur la même ligne, tiens tiens… Arrête Herlock Sholmes, il n’y a pas de rapport), et c’était le premier assassinat dans l’histoire des chemins de fer suisses, dans le métro de New York ils en ont tous les mois, alors vous voyez.
En quittant mon bureau, je ne pensais qu’au train postal, c’est à peine si je savais ce que Mario Blanc, fondé de pouvoir d’une entreprise de transports, attendait de moi.
J’ai passé du temps à discuter une affaire si ordinaire que je ne m’en souviens même plus en détail.
Lorsqu’on a eu terminé, il était midi, et le fondé de pouvoir m’a offert l’apéro. En deux minutes, on reparlait déjà du train postal, bien entendu.
«J’ai de la peine à y croire», ai-je dit.
«Oui, ce n’est pas courant. On se demande d’ailleurs ce que ces gens-là cherchaient, ils n’ont pas tout emmené. C’est peut-être parce qu’ils ont été interrompus.»
«Ah bon, interrompus?»
«Oui. Un des passagers est venu voir ce qui se passait parce qu’il avait remarqué quelque chose de bizarre en allant aux toilettes, alors les bandits sont allés dans le compartiment de première classe, ils ont tenu les passagers en respect avec un pistolet-mitrailleur et, avant de descendre du train, ils ont lancé une bombe lacrymogène dans le compartiment.»
«Vous m’en direz tant! Ils n’ont pas dû vivre une histoire comme celle-là depuis la guerre du Sondrebond, dans ce pays. Moi, j’étais à Paris, et depuis que je suis rentrée, on ne me parle que de ça.»
Je n’ai pas mentionné mon intérêt professionnel pour le rocambolesque train. J’ai pour règle de ne jamais discuter les affaires d’un client avec un autre, même lorsqu’il s’agit d’un inoffensif hochet.
Sophie a mis sur mon bureau une description du paquet de Madame Varek. C’était une de ces boîtes jaunes que l’on achète à la poste pour quelques francs. Madame V. l’avait bourrée de ouate, avait mis le hochet au milieu, attaché le paquet en utilisant la ficelle fournie avec la boîte et l’avait adressé avec l’étiquette que la poste préimprime aimablement sur le couvercle.
J’ai soupiré.
Combien d’emballages de ce genre est-ce que la Poste vend chaque jour à travers la Suisse? Cinquante? Cent? Autant chercher la proverbiale aiguille dans la botte de foin, bien connue elle aussi, mais non moins décourageante.
Le paquet qui m’occupait et commençait à me préoccuper, était adressé à Madame Marinette Bonni-Varek à Lausanne, et cette adresse était tout ce qui le distinguait de ses cinquante, ou cent, frères jumeaux.
Il m’a fallu l’après-midi pour trouver un fonctionnaire des chemins de fer qui consente à me renseigner sur le fourgon postal. J’ai fini par être mise dans le secret grâce à Jean-Marc Léon, l’inspecteur de la police vaudoise rencontré à New York, à qui il m’est arrivé de rendre service, et qui me donne un coup de pouce ici et là.
Le fourgon était à Lausanne dans un hangar spécial, on le passait au peigne fin.
Le lendemain matin, j’ai mis deux bonnes heures pour retrouver le policier chargé de centraliser l’enquête, dont j’imaginais qu’elle allait être complexe: postes, chemins de fer, polices cantonales vaudoise, fribourgeoise, et sans doute aussi police fédérale. Une brochette de fins limiers.
N’amenez pas dans ce guêpier-là quelqu’un qui vient réclamer un hochet. Ce n’est pas sérieux.
«On a déjà eu une vieille folle au bout du fil hier, vous n’allez pas recommencer!»
«C’est une originale, je suis d’accord avec vous. Mais elle veut son hochet et elle ne nous fichera pas la paix si on ne fait pas quelque chose. Alors soyez chic, laissez-moi voir le wagon, laissez-moi voir ces paquets éventrés, et le tour sera joué.»
«Vous savez d’où elle sort, votre originale? C’est la mère du conseiller national Klaus Varek, un politicien qui pèse lourd, si vous me passez l’expression.»
«Pourquoi me dites-vous cela?»
«Pour vous expliquer que, avec des gens comme les Varek, le tour n’est jamais joué. Vous verrez qu’elle continuera à vous harceler jusqu’à ce que vous vous mettiez à considérer, vous aussi, que ce hochet est une affaire d’État.»
Paroles prophétiques s’il en fut.
Il m’a permis de voir le wagon. Je suis allée à Denges, dans un endroit que je n’avais jamais observé parmi les rails et les signaux, les hangars, les containers, les hucklepacks et les wagons en sommeil. Rien de spécial. Un fourgon comme on en voit tous les jours.
J’ai essayé de poser des questions sur la sécurité de ces wagons. L’inspecteur m’a rabattu le caquet presto bien fait.
«Vous êtes là pour enquêter sur les chemins de fer ou pour retrouver un paquet?»
«Pour retrouver un paquet. Excusez-moi, mais dans le cadre de mon enquête j’ai tout de même le droit de remarquer qu’on entre dans vos fourgons comme dans des moulins, même lorsqu’il y a des paquets de valeur. Les types qui ont fait ce coup, ce devaient être des amateurs de théâtre, ils avaient envie de s’éclater pour le plaisir. N’importe qui, mais littéralement le premier quidam venu, aurait pu piquer mon paquet même sans hold-up. Permettez-moi cette observation impertinente, cher Inspecteur.»
Il m’a regardée d’un œil torve. Je l’ai ignoré:
«Je pourrais voir les paquets éventrés?»
«Pour quoi faire?»
Pour quoi faire! Une autre manière de dire mêlez-vous de ce qui vous regarde. Depuis le début de l’enquête, ils n’arrêtaient pas de faire obstruction. Par Machiavelli interposée, la mère V. les emmerde, voilà la vérité.
«Pour en faire des montgolfières», que je lui ai fait.
«Tordant. Ils ne sont pas là. Ils sont à Lausanne.»
«Pas de problème, je vais aller à Lausanne. Nos trains étant les mieux policés du monde, je ne risque guère que d’être poignardée ou dévalisée. Où, à Lausanne?»
Il lui a fallu dix minutes d’atermoiements avant de lâcher le morceau. Au commissariat de la gare. Comme renseignement, c’était bouleversant. C’était le premier endroit où je serais allée.
J’avais raison de penser que ce serait long. Lorsque je me suis retrouvée au commissariat de la gare, face aux paquets, le soir tombait. Ce n’est pas allé tout seul, mais je ne vais pas allonger en racontant toutes les feintes qu’ils ont utilisées pour éviter de me montrer lesdits paquets.
J’ai fini par les voir.
Il y en avait une dizaine d’éventrés. Il y avait deux boîtes jaunes de celles que vend la Poste, et sur l’une d’elles on distinguait, sur un lambeau de ce qui restait du couvercle, un «…nn». C’était peut-être la mienne.
Elle était vide.
«Vous avez analysé les résidus à l’intérieur?»
«Oui, il y avait de la ouate bleu ciel, probablement», m’a dit le fonctionnaire après avoir consulté le procès-verbal.
Il y avait une deuxième boîte jaune, toute pareille à l’autre. Sur celle-là, on ne distinguait plus rien.
«Et dans celle-là?»
«Rien.»
«Et alors?»
«Ils n’ont pas trouvé ce qu’ils cherchaient, ils ont été dérangés par le passager de première classe et ont emporté les autres paquets. C’est en tout cas ce que nous pensons.»
«Si vous n’avez plus besoin de ces boîtes, je pourrais les montrer à Madame Varek.»
«Après tout, pourquoi pas? Prenez-les, vous les ramènerez.»
Avant de me les donner, il m’a fait signer quatre papiers, bien sûr, et je ne disposais de ces boîtes que pour vingt-quatre heures.
À neuf heures, je me suis retrouvée ruelle du Rôtillon, assise à ma table, les deux boîtes devant moi. Je me suis mise à les tripoter, distraitement. Il n’y avait pas véritablement de doute. Celle de Madame Varek était la plus éventrée, mais aussi la plus reconnaissable. Il y avait l’étiquette, et à la loupe j’ai même déchiffré le sceau de la poste, très mal imprimé; il commençait par un 3, le premier chiffre du 3000 de Berne. Hasard ou pas, elle avait été ouverte, et j’étais prête à parier que le vieil hochet de famille avait dû être un objet très esthétique. Il avait tenté quelqu’un.
Dans le silence nocturne, on entendait le ronronnement des voitures dans la rue Centrale, l’artère qui coupe le cœur de la ville en deux. Bordée de magasins des deux côtés, elle a tout de l’autoroute. Quatre pistes et passage obligé pour aller de pas mal de lieux à pas mal d’autres lieux. Je ne comprendrai jamais les urbanistes, et encore moins les commerçants qui réclament à cor et à cri qu’on puisse parquer devant leur magasin alors que les gens aiment si visiblement les rues piétonnières. Parfois, comme à cet instant, je me surprenais à rêver de la beauté que devait déployer ce vallon à l’époque où le Flon y coulait paisiblement, je parle du temps lointain avant qu’on ne recouvre cette petite rivière pour faire la rue Centrale par-dessus, transformant ainsi une verte colline en désert de macadam. Je me demande si depuis la fenêtre ouverte de ma maison, qui est bien plus ancienne que la rue Centrale, on entendait, à l’époque, les oisillons pépiants, réveillés dans la nuit par un froissement de branches…
À propos de froissement, il y avait un bruit dans l’escalier, ce n’est pas que je sois peureuse, mais enfin, il était presque dix heures. C’était peut-être le céramiste, un monsieur d’un certain âge qui avait des insomnies. Si c’était lui, je lui demanderais des renseignements sur Klaus Varek: les politiciens sont son dada, il est incollable sur la composition de je ne sais combien de gouvernements fédéraux et cantonaux successifs.
J’ai jeté un coup d’œil dans la cage d’escalier. C’était Rico Kepler, le journaliste. Il m’a souri. Irrésistible. C’était un géant de presque deux mètres, le teint rubicond et l’allure du quadragénaire qui a bien bu, bien festoyé, bien mangé, le cheveu sombre, abondant et bouclé, l’œil d’encre, et la moustache itou. Il avait la voix un peu éraillée des chanteurs de flamenco. Lorsqu’il souriait, c’était comme s’il vous prenait dans ses bras. J’avais déjà pensé ça deux ou trois fois, depuis qu’il avait emménagé à l’étage au-dessous, quelques semaines auparavant.
«Salut», qu’il a fait de sa voix sexy. «Vous travaillez tard.»
«Salut, vous aussi, vous voulez entrer?»
Je ne sais pas pourquoi je l’ai invité. Probablement parce que là d’où je sors on considère que c’est chouette que les gens passent à toute heure. Alors quand ils sont sur votre palier et qu’en plus ils ont un sourire d’ange et une voix sexy…
Il est entré et je nous ai servi un whisky. On a bavardé, un rien timides tous les deux, on ne se connaissait pas.
Il travaillait pour plusieurs journaux.
«En ce moment, avec tout ce qui se passe en Suisse, je mène une vie de forçat: la crise, les fusions, les scandales – je n’en dors plus.»
«Vous travaillez la nuit?» a-t-il fini par demander. Il n’avait pas la moindre idée de ce que je fais pour gagner ma vie.
J’ai expliqué Madame V. sans la nommer, et ses boîtes.
«Et comme je les ai récupérées en fin d’après-midi, j’étais occupée à les retourner sous toutes les coutures pour tenter d’en tirer une idée. La seule qui me soit venue, c’est d’aller acheter un autre hochet. Mais je crains que la dame ne l’entende pas de cette oreille-là.»
J’ai repris la boîte qui aurait pu venir de Madame Varek.
«Je ne sais même pas exactement pourquoi je les ai emmenées. Pour aller voir cette dame et la convaincre, je suppose.»
Je crois que lorsque vous avez bien appris un métier que vous aimez, vous finissez par posséder un instinct qui fait de vous ce qu’on appelle un professionnel, certaines choses se passent ailleurs que dans la raison, on ne sait pas pourquoi on les fait, et quand cela produit des résultats, on parle de hasard. Mais ce n’est pas le hasard. Quelque part on savait. Et voilà qu’on se retrouvait autour de ce bureau, deux personnes habituées à chercher, à déduire, je crois que dans le silence de la nuit, pendant un instant, nos deux instincts se sont alliés, nous nous sommes mis à manipuler cette boîte, nous nous sommes mis à la voir, nous étions branchés dessus. On percevait encore les traces de la poudre qu’ils avaient employée pour prendre les empreintes, mais à part cela c’était une boîte comme les autres, la ficelle bien en place, ils avaient photographié les nœuds parce que pour un spécialiste un nœud c’est comme une signature, et soudain Rico et moi étions en train d’enlever la ficelle et de démonter la boîte, une de ces boîtes qu’on achète à plat à la poste et qu’on peut remettre à plat. Et dans le pli de cette boîte jaune si ordinaire, il y avait un morceau de papier, coincé entre les deux languettes et impossible à repérer à travers l’épaisseur du carton. Je ne comprends toujours pas aujourd’hui comment il se fait que nous l’ayons vu et que aussi bien les malfaiteurs que les flics l’aient manqué. Parce que, comme moi, ils étaient braqués sur le hochet, probablement. Peut-être l’avais-je déjà senti et dans mon inconscient savais-je qu’il serait là, car cette fois j’y suis allée comme une somnambule, et je l’ai extrait.
Il ne m’a fallu qu’un coup d’œil pour l’identifier. C’était un ticket de consigne; il venait de la gare de Berne. Caractéristique, avec son impression de style vieillot, en noir sur bleu. Le bagage avait été déposé neuf jours auparavant.
Rico et moi avons échangé des sourires idiots, comme des gamins qui ont trouvé une pièce difficile du puzzle – on est forts, hein?
On s’est mis à rire, tous les deux, d’un rire un peu ivre, le whisky y était pour quelque chose, mais pas encore trop, nous n’en étions qu’au deuxième, ce qui nous speedait, c’était surtout le ticket.
Je l’ai posé sur la table d’un geste théâtral.
«Rico, je vous remercie, sans vous, je n’aurais pas trouvé.»
«Je n’en crois pas un mot. Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait?»
«Je vais voir Madame… Enfin, cette dame, et…»
«Vous permettez que je me mêle de vos affaires, Marie?»
«Allez-y.»
«Ne cédez pas si facilement. Vous ne savez pas ce qu’il y a, à cette consigne. C’est peut-être l’arme d’un crime. Sinon, pourquoi ce reçu serait-il si bien caché? Pourquoi a-t-on voulu voler cette boîte?»
«Nous ne savons pas avec certitude que c’est cette boîte qu’on a voulu voler. Ils ont emmené plusieurs sacs de courrier, ils ont inspecté quelques-uns de ces paquets juste pour voir, ou parce qu’il leur restait du temps.»
«C’est vrai. Mais croyez-moi, à votre place, je serais prudente.»
S’il avait raison, s’il y avait crime, et que cela était découvert, j’étais complice. Conseiller national ou pas, il fallait que je me défie de Madame Varek. Elle avait peut-être voulu se servir de moi. Avoir trouvé ce reçu, c’était peut-être même dangereux. J’ai fait la seule chose possible en la circonstance: j’ai voulu parler à mon avocat.
J’ai appelé chez Pierre-François.
À cette heure-là, il était aux abonnés absents, j’aurais dû m’y attendre. Il n’était pas non plus au Pianissimo, ni au Carlton. À tout hasard, j’ai encore essayé chez les Girot, les forains dont il est copain. C’était l’heure où ils venaient de fermer les métiers. J’ai fait mouche.
«Écoute, Pierre-François, j’ai besoin d’un coup de main.»
«Maintenant?»
«Oui, urgemment, même. Tu peux venir au Rôtillon?»
«Si vraiment tu penses que c’est urgent…»
«Je le pense. Les gens sont encore debout, chez les forains?»
«Oui. On ferme tout juste.»
«Tu peux prendre un ou deux malabars avec toi? Des types solides, tu vois?»
«Marie, t’es tombée sur la tête?»
«Non, Pierre-François. Je t’expliquerai. Commence par amener tes malabars.»
«Pour faire quoi?»
«Pour escorter un papier jusqu’à ton coffre.»
«Maintenant?»
«Maintenant.»
«Bon, puisque tu insistes. J’arrive. Le temps de convoquer la troupe.»
«Dépêche-toi.»
«Je… Bon, j’arrive.»
Ça leur a pris un quart d’heure.
J’ai entendu la voiture dans la ruelle, j’ai reconnu le bruit du moteur.
Je n’ai pas pris de risque. Entre-temps, j’avais décidé que Rico avait peut-être vraiment raison. J’ai sorti mon revolver du double-fond de mon bureau, je me sentais ridicule, mais mieux valait ridicule que crevée. Qui me disait qu’il n’y avait pas quelqu’un qui guettait mes faits et gestes pour voir ce que je trouverais? Plus j’y pensais, plus le coup de la grand-mère me semblait bidon. Hochet… Tu parles. Pendant que j’attendais, j’ai mis le reçu dans une enveloppe que j’ai scellée.
Quand il a vu le revolver, Pierre-François a fait des yeux ronds, mais il m’a prise enfin au sérieux. Il sait que j’abats une mouche à cent pas. Littéralement. Mes yeux portent à des kilomètres, un don de naissance. Je n’ai jamais eu à me servir de mon arme pour me défendre, mais savoir tirer avec précision m’a évité deux ou trois fois des réflexes de panique qui auraient pu me coûter cher.
J’ai présenté Rico à Pierre-François. Ils se sont serré la main sans rien dire.
Les malabars étaient vraiment des costauds, des Valaisans, je l’ai constaté à leur accent, personne ne dit bonsoir comme un Valaisan. Chez tout un chacun ça donne quelque chose comme «bonsouaar», chez les Valaisans ce serait plutôt «bonsouôôr».
J’ai enfilé l’enveloppe et le revolver dans mon sac, branché le répondeur, éteint les lumières, fermé la porte à double tour. Nous étions déjà descendus d’un étage quand, à la réflexion, je suis remontée, ai mis les deux boîtes jaunes dans le sac en plastique que m’avait donné le flic, et je les ai embarquées. Demain matin à la première heure, j’irai à Berne. Je voulais voir la mère V. en face.
Nous nous sommes enfilés en silence dans la voiture.
À l’étude, Pierre-François a ouvert son coffre, j’y ai mis mon enveloppe, il a refermé.
«Il faut que je ramène les hommes», a-t-il remarqué.
«Bien sûr. Je viens aussi.»
Les forains étaient installés à Ouchy, autrefois on ne les voyait qu’en été, maintenant que nous avons tous de bons manteaux et des moon-boots, ils viennent en tout temps. On a posé les hommes, je leur ai donné cinquante francs chacun. Daniel Girot qui nous guettait a passé la tête à la fenêtre de la roulotte:
«Venez boire un coup!»
Daniel Girot est un jeune forain entreprenant qui a, de mon point de vue, le mérite insigne de posséder une superbe grande roue (la plus haute de Suisse) qui ne me donne pas le mal de mer. Lorsqu’il croise ma route, j’y passe souvent des heures (tous les forains de Suisse ont fini par me connaître, je suis une cliente acharnée). Bâle, ou Berne, ou Vufflens-le-Château du haut de la grande roue des Girot – je conseille vivement. Tout y est différent.
S’il n’avait pas été forain, Daniel aurait pu faire un excellent détective. Une fois il m’a aidée à retrouver une adolescente qui était allée se fourrer dans une de ces sectes qui ont de la peine à lâcher prise. Une fille d’à peine seize ans. Daniel avait bel et bien réussi à l’enlever, à faire ce qu’il avait baptisé pour l’occasion du contre-kidnapping. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il a un esprit de déduction qui fonctionne comme le mien. Je peux toujours vérifier mes raisonnements, avec lui. C’est subjectif, je l’admets.
Pendant que nous buvions ce qui devait être mon septième whisky de la soirée, j’ai déballé mon histoire. Pierre-François écoutait comme il le fait toujours, sans bouger un muscle, en me fixant de ses grands yeux gris: demain, il saurait par cœur tout ce que j’avais dit. Ici et là, Rico complétait d’un détail.
Lorsque j’ai terminé, un silence s’est instauré. Il a bien fallu trois minutes pour que Daniel pose à voix haute la question qui trottait dans les têtes:
«Et maintenant?»
«Deux choses», a dit Pierre-François. «Il faut aller voir à la gare de Berne ce que c’est que ce bagage. Il faut que Madame V. ne s’en doute pas – il faut d’ailleurs qu’elle ne sache pas que nous avons le ticket.»
«Demain matin, je vais la voir avec les boîtes.»
«Marie, un débiteur récalcitrant, plus on le regarde dans les yeux, plus il flanche. Mais si tu avais affaire à un criminel, ça pourrait être une autre paire de manches. Il faut y aller mollo.»
Côté travail du chapeau, Pierre-François me battait à plates coutures. J’ai failli lui en faire la remarque, mais son expression m’a retenue. Je me suis contentée d’un:
«Qu’est-ce que tu suggères?»
«Tu ramènes les boîtes aux flics, tu téléphones le résultat de tes recherches à Madame V., tu es ostensiblement présente et oisive à Lausanne, tu fais une facture et tu t’avoues battue. Tu n’as pas retrouvé le hochet. C’est la stricte vérité.»
«Et moi», est intervenu Daniel, «je vais à Berne à l’aube et je retire le colis.»
«Il y a peut-être quelqu’un qui guette, à cette consigne.»
«Tu me fais confiance, oui ou non?»
«Je te fais confiance. Mais…»
«Je suis un prestidigitateur de première, tu t’en souviens? J’ai travaillé au Cirque Nock, tu te rappelles?»
Oui, je me rappelle, c’est même là que je l’ai rencontré. Parce que les cirques aussi… Une de mes faiblesses.
Nous sommes finalement convenus que Daniel partirait avec les deux malabars. Il est allé voir son père pour lui annoncer qu’il s’absentait. Dans le lointain, on a entendu sans distinguer les mots la voix du père Girot qui râlait – plus pour le principe que parce qu’il était fâché. Il était fier de ce fils aux multiples talents, dont il disait parfois que ce n’était pas un vrai forain, et à d’autres moments que c’était le plus forain de tous, justement parce qu’il savait faire tant de choses, comme les jongleurs d’autrefois.
Rico et moi sommes rentrés nous coucher, chacun chez soi. Daniel et Pierre-François sont remontés à l’étude chercher le ticket de la consigne.
Le lendemain matin, j’avais une gueule de bois à crever. Boire jusqu’à plus soif n’est pas ma spécialité, jamais mon foie ne supporterait les quantités d’alcool que certains de mes copains ingurgitent sans qu’il y paraisse.
La tête écrasée par une migraine à vous rendre fou, je suis allée rapporter les boîtes. L’inspecteur m’a lancé un coup d’œil en dessous:
«Vous avez trouvé un indice, Miss Marple?»
J’ai tout juste réussi à esquisser un sourire.
«Bien entendu. L’arme du crime dans la commissure des interstices. Le coupable, c’était le cousin de la petite amie du frère de la mère de la victime.»
«Je pensais bien que vous sauriez tirer profit de ces emballages.»
Nous avons ri, tous les deux. J’ai cru que ma tête allait exploser.
Je suis retournée au bureau.
Je n’ai même pas essayé de faire semblant de travailler. J’ai appelé Sophie, je lui ai dicté une lettre pour Madame Varek et lui ai suggéré de faire une facture pour la journée précédente.
«Je vais au cinéma.»
«Vous avez branché votre recherche? Juste au cas où…»
«Oui, elle est branchée.»
«Dans ce cas-là, s’il y a quelque chose je vous appelle. Allez cuver votre whisky.»
«Comment savez-vous?…»
Sa voix s’est faite sarcastique.
«Vous avez laissé des traces. Une bouteille qui était neuve hier à moitié vide, des verres sales. Même le misérable Docteur Watson que je suis sait interpréter de tels indices lorsque ensuite, par-dessus le marché, il entend votre voix râpeuse comme une joue mal rasée.»
«Bon, ça va, je suis au cinéma.»
Je suis allée voir Shadowlands, parce que j’adore Anthony Hopkins. L’histoire véridique de cette rencontre d’une poétesse américaine avec un écrivain anglais, de la difficulté qu’ils ont à s’avouer – à eux-mêmes d’abord – combien ils s’aiment, m’a absorbée complètement, et il a sans doute fallu que ma recherche bipe plusieurs fois pour que je l’entende. Nous en étions au moment le plus captivant du film, celui où elle sait qu’elle va mourir de tuberculose osseuse et veut convaincre son écrivain de mari (car ils se sont mariés, entre-temps) et son fils qu’elle restera avec eux même après sa mort.
À la lumière de ma lampe de poche, j’ai lu le message:
«Pierre-François 17 h cabine 1.»
Ma montre indiquait 16 h 45. J’avais juste le temps de voir la fin du film, du moins je l’espérais. Lorsque Pierre-François parlait de cabine, cela signifiait qu’il était ou que je devais me rendre dans une cabine publique convenue (nous en avions trois, dans trois quartiers différents), parce qu’il avait peur d’être entendu.
Bien entendu la fin du film a été empoisonnée par la question lancinante: qu’est-ce qu’il peut avoir à me dire de si important et de si confidentiel?
Je suis sortie du cinéma en trombe dès la dernière image. Contre toutes mes habitudes, je n’ai même pas attendu la fin du générique. Il faudrait que je vienne revoir ce film un jour où je n’aurais vraiment rien d’autre à faire.
Je suis arrivée à la cabine juste à temps pour répondre à la sonnerie.
«Devine ce qu’il y avait, à la consigne de Berne?» m’a dit Pierre-François en guise de bonjour.
«Des armes.»
«Faux.»
«De la drogue.»
«Encore faux.»
«Ne me fais pas languir.»
«Des films pornos.»
«Tiens, tiens. Inattendu. Je devrais me scandaliser?»
«Si tu voyais ce qui se passe sur ces bandes…»
«Tu sous-entends que Clara Varek, mère de conseiller national, quatre-vingts ans, fait commerce de bandes pornos?»
«C’est ce qu’on pourrait penser en voyant ces cassettes. Il y en a plusieurs exemplaires de chaque sorte, et on a même trouvé un bulletin de livraison. Sans nom et sans adresse, hélas!»
«Prévenons les Mœurs.»
«Je t’appelle depuis Berne, Marie.»
«Depuis Berne…» Ma gueule de bois n’arrangeait pas les choses. «Pierre-François, explique-toi clairement.»
«Daniel et ses deux cousins sont arrivés à Berne à sept heures ce matin. Ils sont allés chercher ce bagage, une valise en cuir fin qui vaut deux mille balles à elle seule, soit dit en passant. Elle appartient à un certain D. Carlini, c’est en tout cas le nom qu’il y a sur l’étiquette. Ils ont loué une chambre d’hôtel après avoir pris mille précautions pour s’assurer qu’ils n’étaient pas suivis. Et ils ont ouvert la valise. À neuf heures ils m’ont téléphoné pour me dire qu’ils venaient de visionner une bande. J’ai appelé les Mœurs, et à midi je suis parti avec un inspecteur.»
«Vous auriez pu me prévenir.»
«Ne dis pas de bêtise, toi il fallait que tu sois bien visible, et bien calme. Toi, dans ces sacrées boîtes jaunes, tu n’as rien trouvé. À propos, j’ai emmené ton journaliste.»
«Quel journaliste?»
«Rico Kepler. Je n’étais pas sûr… J’ai préféré prendre les devants. Mais je crois que ce n’est vraiment qu’un simple journaliste. Enfin, simple… Il écrit comme un fou, et lorsque cette histoire sortira il fera un tabac. Tu sais qu’il en pince pour toi.»
Je me suis sentie rougir, bêtement.
«Ah bon? Concrètement, qu’est-ce que je fais, maintenant? Je vais chez le juge, j’espère? On ne va pas garder une découverte pareille pour nous? C’est malsain.»
«Non, le juge, c’est moi qui l’appelle. Toi, tu continues à ne rien savoir.»
J’ai passé une nuit blanche.
Lorsque je suis arrivée au Rôtillon le lendemain matin, un cliquetis en rafale sortait du bureau de Rico, dont la porte était entrouverte. J’ai poussé, pour voir. Il était assis devant son écran, sa chemise sortait de son pantalon, il n’avait pas dû se raser depuis deux jours. Il n’a pas levé les yeux, son rythme ne s’est pas ralenti. Il a juste dit:
«Posez sur la table, merci.»
«Rico!»
Il s’est retourné d’un coup.
«Marie!»
Il s’est levé, m’a entourée de ses bras et il m’a embrassée sur la bouche. Comme ça. Le plus étonnant, c’est que moi aussi, je l’ai embrassé.
Après, il m’a souri, et il a dit:
«Bon dieu, ça fait plaisir de te voir, Marie. Dès que j’ai fini mon article, on fête ça.»
«Attendez… Attends une seconde…»
Il ne m’écoutait déjà plus.
J’ai laissé tomber et suis montée à mon bureau.
Deux hommes buvaient le café avec Sophie.
«Inspecteurs Pascal Rochat et Richard Davent, de la Brigade des Mœurs», se sont-ils présentés.
Ils voulaient que je voie la valise, histoire de l’identifier – peut-être, on ne savait jamais. Les cassettes pornos étaient restées à Berne.
C’était sans conteste la plus belle valise que j’aie jamais vue. Un instant, il m’a semblé pouvoir l’associer, mais l’image parallèle m’échappait.
Une fois qu’ils sont partis, Sophie a égrené la liste des coups de fil que j’avais déjà reçus ce matin-là. Impressionnante. Et Madame Varek?
Madame Varek n’avait pas appelé.
«Vous avouerez que c’est curieux. Une femme aussi persistante.»
«Vous lui avez dit que votre enquête était terminée. Que voulez-vous qu’elle ajoute encore?»
«Mais enfin, c’est dans son paquet… Non, bien sûr, on ne prouvera jamais que c’est dans son paquet qu’on a trouvé le reçu. Le reste ne la regarde pas. Qu’elle soit au courant ou non, elle ne bougera pas.»
Elle n’a plus appelé. Elle a payé la facture sans commentaire.
En faisant quelques ellipses (il n’a jamais dit que nous avions trouvé le ticket de consigne nous-mêmes, par exemple, nous avons laissé le mérite de la découverte à la Brigade des Mœurs), Rico a sorti l’histoire dans un hebdomadaire et cela a fait beaucoup de bruit. Je n’ai vu aucune des bandes, mais aussi bien Pierre-François que Rico m’ont assuré que cela valait mieux. On n’a bien entendu jamais retrouvé le mystérieux D. Carlini et rien n’a été retenu contre Varek, dont il a pourtant été question pour la bonne raison que Madame Varek avait beaucoup insisté pour retrouver son hochet – disparu évidemment à jamais. Les policiers, Rico et moi-même sommes restés persuadés que cette valise était à lui, qu’il l’avait déposée à la consigne, ou qu’il aurait dû y aller la chercher.
En jonglant avec les mots Rico l’avait, dans son article, accusé d’être un pervers sexuel. Il s’en est indigné, bien entendu; son avocat a menacé bruyamment. Mais finalement, ils ont laissé tomber. La police aussi. J’ai gardé l’interrogation dans un coin de ma mémoire, un jour je trouverai peut-être…
En attendant, j’avais autre chose à faire. Dès le lendemain, notre attirance mutuelle s’est transformée en passion – deux mois plus tard Rico et moi déménagions dans un grand appartement de l’avenue de Rumine, avec vue sur le Léman tout entier. Moi qui avais juré que jamais plus je ne me serais mariée, je me mettais en ménage. Je ne me mariais pas, bien sûr. Mais soyons francs, c’était tout comme.
© Bernard Campiche éditeur, CH 1350 Orbe (Suisse)
«Ame de bronze» a été réalisé par Bernard Campiche avec la collaboration de René Belakovsky, Béatrice Berton, Marie-Claude Garnier, Marie-Claude Schoendorff et Daniela Spring. Photo de couverture: Daniel Cochet.
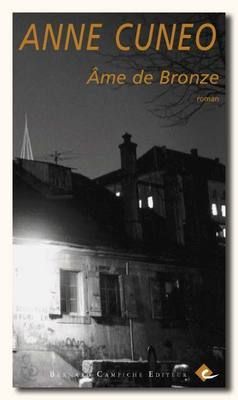
, le 31.08.2008 à 10:13
La lecture du roman-feuilleton sur cuk.ch le dimanche matin est devenue une coutume bien établie chez moi :-)
Une question : ce livre est-il une succession d’enquêtes courtes qui n’ont pas grand’chose à voir les unes avec les autres, ou bien y a-t-il un lien qu’on verra plus tard ?
C’était une remarque en passant dans le cours de l’enquête :
Hé bien moi non plus, je n’ai jamais compris…
, le 31.08.2008 à 10:47
Dans le foyer d’un théâtre hier soir, ai rencontré un Bernard Campiche débordant d’anecdotes affectueuses sur la famille Cuneo. Du coup j’ai oublié de lui dire combien, en plus de la qualité littéraire, j’appréciais aussi la qualité esthétique et tactile des livres qui sortent de chez lui ; notamment le papier, du papier vergé il me semble.
Bonne lecture aux amoureux transis de Marie Machiavelli. Il est bien entendu exclu de répondre à leurs questions ;-)
, le 31.08.2008 à 17:36
Au moins on ne s’embarrasse plus d’Alfa…
OK, je >>> mais avant je ne saurais jamais remercier autant Anne des pépites qu’elle dépose comme un petit Poucet ses cailloux, tous les dimanches.
, le 31.08.2008 à 18:11
Borelek dit: Du coup j’ai oublié de lui dire combien, en plus de la qualité littéraire, j’appréciais aussi la qualité esthétique et tactile des livres qui sortent de chez lui ; notamment le papier, du papier vergé il me semble.
Mais tu peu lui envoyer un mail,cela lui fera certainement plaisir :) Bonne soirée :)
, le 31.08.2008 à 18:29
il a peut-être une omega le Mr….
je salue ki en sortant
, le 31.08.2008 à 21:46
j’avais fini par décrocher avec “la vermine”… Mais là, je suis haletant ! Je me suis payé les 3 millenium pendant l’été, alors je suis en forme pour les polars. Marie sera-t-elle aussi bandante que Lisbeth? En tout cas, c’est bien parti, et pour l’histoire, et pour l’écriture…
, le 03.09.2008 à 19:00
Une semaine sans liaison, je n’ai pu que débloquer mon courrier pour le lire. Mais me voilà de retour et câblée… Pour te dire: patience, Franck, patience, tu verras bien ce qui se passe.