… Je n’aime pas l’étiquette «romans policiers». Pour ce genre de bouquins, je préférerais quelque chose comme «chronique domestique». Après tout, c’est de notre quotidien qu’ils parlent.
Chester Himes
Giovanni
Amico, che ti par?
Leporello
Mi par che abbiate un’anima di bronzo.
Giovanni
Va là, che sei un gran gonzo!
Lorenzo Da Ponte/W.A. Mozart
Don Giovanni
Giovanni
Mon ami, que te semble?
Leporello
Il me semble que vous avez une âme de bronze.
Giovanni
Va donc, tu n’es qu’un niais!
I
Lorsqu’il est entré dans mon bureau, qu’il s’est assis dans mon fauteuil miteux, qu’il a rajusté d’une chiquenaude digne d’un film haut de gamme le pli impeccable de son pantalon, il a changé ma vie.
Mais ni lui ni moi ne nous en sommes rendu compte, à cet instant-là. Il s’est présenté à moi sous le nom de Thomas Carlyle, et comme il était grand, blond, gentleman et Britannique jusqu’au bout des ongles, je n’ai pas songé à le mettre en doute. Il avait, certes, ce qu’il est convenu d’appeler des yeux de braise. Mais cela ne suffisait pas à faire supputer le voyou, bien caché derrière un superbe costume croisé et un accent oxfordien tiré au cordeau.
Je suis enquêteuse. J’ai trente-huit ans, me suis mariée à dix-sept ans et mon divorce a été prononcé le jour de mes vingt ans. J’avais commencé les démarches deux ans auparavant, mais le juge m’a renvoyée deux fois parce qu’il m’estimait trop jeune pour savoir ce que je voulais. Il avait tort. Il ne m’avait fallu que quelques semaines pour réaliser que l’«on» attendait de moi que je surnage non seulement dans la mare de mes propres problèmes, mais aussi dans l’océan des problèmes de Denis, mon mari, un homme dont j’avais naïvement pensé qu’il aurait réponse à tout. À l’époque, je ne concevais pas qu’un «vieux» de vingt-quatre ans puisse compter sur l’aide du «bébé» que j’étais pour guérir son vague à l’âme.
Mais je ne suis pas là pour parler de mon mariage. Le fait est que je suis divorcée.
Je sors d’une famille très ordinaire, à cela près que nous nous appelons Machiavelli. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à porter ce nom-là, mais l’ancêtre Niccolò nous fait la vie dure. Un type sensationnel. N’empêche que quand vous dites je m’appelle Machiavelli, c’est sans arrêt des plaisanteries du genre moi je suis Michel-Ange ou qu’as-tu fait de Borgia?
Je m’appelle Marie Machiavelli. Rose, ma mère, qui aimait mon père à la folie, a failli céder et m’appeler Nicoletta. Nicoletta Machiavelli, vous voyez le tableau. D’ailleurs on me demande parfois pourquoi je ne me prénomme pas Nicole. Je n’ai qu’une explication: au moment de me baptiser, ma mère a dû décider qu’elle ne serait pas une femme soumise. Elle avait envie de m’appeler Marie. Elle m’a appelée Marie. Nicoletta, ce n’est même pas mon second prénom.
Ma mère s’est fait écraser par une voiture lorsque j’avais à peine sept ans. Elle n’en avait que vingt-huit. J’ai toujours regretté de ne pas l’avoir mieux connue. Je n’ai d’elle que des souvenirs lumineux et flous.
Mon grand-père paternel était un Toscan de Toscane, il descendait vraiment du grand Machiavel, en tout cas il en était intimement persuadé. Il a émigré en 1925 avec son jeune fils après que les chemises-noires mussoliniennes ont organisé une expédition punitive contre sa maisonnette de prolétaire. C’était «seulement» pour lui faire peur, mais l’aventure a mal tourné. Dans l’échauffourée (mes grands-parents ayant activement refusé d’avaler l’huile de ricin avec laquelle on faisait à l’époque chier le socialiste), ma grand-mère a reçu un tel coup sur la tête qu’elle en est morte. Le coupable a fait quelques jours de prison, mais mon grand-père n’a pas attendu que les fascistes reviennent le voir. En huit jours il avait confié sa ferme à son frère et, accompagné de son fils unique Orlando, qui allait devenir mon père et qui avait alors trois ans, il était parti pour Paris où un maçon italien trouvait toujours du travail et où l’opposition au fascisme s’organisait dans l’idée qu’on aurait vite éliminé Mussolini. Et puis cela avait duré, et mon grand-père avait trouvé un travail plus intéressant en Suisse.
Lorsqu’ils sont arrivés à Lausanne, mon père avait douze ans et parlait bien le français, avec une pointe d’accent toscan héritée de son père (lequel n’a pas vraiment appris la langue) qu’il n’a jamais perdue. Il est allé à l’École de commerce, a acquis (très cher) la nationalité suisse, a francisé son prénom en Roland, et de fil en aiguille il s’est retrouvé agent d’affaires. Il a épousé Rose, une Yverdonnoise, et il est devenu un de ces Suisses genre Brown, ou Boveri, qui amènent un vent d’ailleurs et s’intègrent parfaitement. Comme je suis restée enfant unique, il a été entendu tôt que je serais agent d’affaires. J’ai fréquenté un des lycées de Lausanne, une ville dont il n’y a rien à dire.
C’est une très belle ville, mais si elle vous intéresse il faudra vous renseigner ailleurs. Je crois qu’une fois ils ont signé un traité, à Lausanne, il y a longtemps. Dans Tendre est la nuit, Scott Fitzgerald mentionne en passant qu’on y trouve les plus belles filles du monde et beaucoup de corruption. Pour ce qui est des filles, je ne peux pas juger. Pour la corruption, Lausanne n’est pas une capitale. Elle a longtemps réussi à faire croire qu’ici, il en va de la corruption comme du reste: c’est ni oui ni non, bien au contraire. Les «affaires» qu’on découvre ces dernières années n’ont rien en commun avec celles qui ont défrayé la chronique des pays voisins.
J’ai passé tôt ma maturité (en français bachot). C’est là que se place l’épisode de mon mariage.
À dix-huit ans j’avais déjà réintégré le giron familial, et papa a eu la générosité de ne pas remarquer «Je te l’avais bien dit» (il ne me l’avait pas seulement dit, il me l’avait répété jusqu’à l’épuisement). Il m’a suggéré de meubler mon indépendance retrouvée en entamant des études universitaires.
Au départ, j’ai eu un peu de peine à choisir, aussi ai-je «fait» Droit, puis, ayant constaté que décidément le barreau ne me disait rien, Sciences économiques. J’ai touché de beaux diplômes et j’ai commencé à travailler avec mon père.
J’ai vite compris: être agent d’affaires, ce n’était pas ma tasse de thé. Aucun intérêt. Toutes les fois qu’il y avait moyen d’être ailleurs qu’à l’agence, j’y courais.
C’est ainsi que, sans m’en apercevoir, je suis devenue une spécialiste de la récupération des dettes difficiles. Aux lettres, avertissements et autres formalités que mon père accomplissait parce que de tout temps le monde des agents d’affaires avait agi dans ce sens-là, j’ai ajouté les enquêtes sur le terrain. On a fini par remarquer, en ville de Lausanne, que pour ce qui était des affaires complexes Marie Machiavelli «savait y faire». Résultat: un beau jour je me suis mise à mon compte. Mon père m’a avertie: je n’avais pas d’avenir – femme, un métier comme celui-là… Le chômage technique me guettait, d’après lui. J’aurais peut-être été au chômage technique en plein boom économique, mais la crise se profilait déjà à l’horizon. Les temps avaient changé, on avait besoin de moi, de plus en plus souvent, même. Pour une fois, mon père s’était trompé.
J’ai fait ce boulot-là pendant sept ou huit ans, avec une interruption de quelques mois que j’ai passés en Amérique dans une école de police qui offrait quelques places de stage à des policiers européens publics et privés.
Les étudiants venaient de tous les pays du monde, et j’ai rencontré des gens qui me sont utiles et à qui je suis utile aujourd’hui encore. Nous étions même deux Romands, il y avait aussi un type nommé Jean-Marc Léon, qui allait devenir inspecteur à la police judiciaire du canton de Vaud, la «Sûreté».
Mon père, beau joueur, a tout payé. J’y ai appris à enquêter systématiquement. Une fois rentrée au pays, je ne m’en suis pas tenue à la récupération de dettes. J’ai retrouvé des maris amnésiques, des épouses égarées, des enfants en cavale, des couverts en argent, des voitures, deux ou trois œuvres d’art, des bricoles.
Je suis devenue «Marie Machiavelli, enquêteuse».
Au bureau, les clients trouvent toujours Sophie, ma secrétaire. Elle tient beaucoup à ce titre de secrétaire parce que (je cite) pour rien au monde elle ne voudrait être détective (fin de citation). Mais, en fait, elle est mon assistante, et détecte comme une grande sans jamais quitter le bureau, même si elle tient farouchement à sa semaine de quarante heures et refuse strictement les coups de main que je suis parfois coincée à demander sur le coup de minuit.
«Vous avez», me dit-elle, «assez d’amis qui seront très heureux de courir les bars aux petites heures, de toute façon ils ne demandent que des prétextes. Pas moi. La nuit, je dors. Je suis secrétaire, et non saltimbanque.»
Lorsque Sophie se met à parler de saltimbanques, il n’y a plus qu’à se taire et à se consoler en pensant qu’il n’y en a point comme elle.
Bon, alors, Thomas Carlyle.
Il est entré dans mon bureau par un matin de printemps. Il arborait un large sourire.
«Comme ça, vous vous appelez Machiavelli», a-t-il dit en guise de bonjour, en anglais.
Au fond de mon sac, il y a un briquet plaqué or. Je le destine au premier qui me fera sur Machiavelli une plaisanterie inédite. Pour l’instant, il n’a jamais quitté les profondeurs où il repose.
«Moi, je m’appelle Carlyle», qu’il a poursuvi. «Thomas Carlyle. La rencontre de deux grands philosophes.»
Je ne me suis même pas donné la peine de sourire. Thomas Carlyle était un écrivain anglais du dix-neuvième siècle. Je n’avais pas complètement oublié les manuels de littérature.
«Très drôle. Vous venez de perdre un briquet», ai-je remarqué sur un ton affable.
«Moi? Pas du tout. D’ailleurs je ne fume pas», et d’une main parfaitement manucurée, il m’a tendu un bristol gravé. «Thomas D. Carlyle, Esq.»
Là, il sortait des sentiers battus. Il s’appelait vraiment Carlyle. J’ai hésité à lui offrir le briquet, mais j’ai renoncé. D’abord, il ne fumait pas. Et puis son élégance impeccable, son anglais de grande école et la politesse exquise qui transpiraient par tous ses pores m’ont retenue.
Je me lave, me maquille, je vais chez le coiffeur et, de sept en quatorze, chez l’esthéticienne et la masseuse. Mais je ne me coiffe pas dix fois par jour. Me remaquiller au début de l’après-midi, ce n’est pas une de mes préoccupations majeures. Les apparences sont secondaires, dis-je volontiers. Pourtant, lorsque je me trouve face à quelqu’un (homme ou femme) qui a l’air de sortir d’une gravure de mode, cela m’intimide toujours.
Thomas Carlyle devait avoir conscience de l’effet qu’il faisait, et je suis prête à parier qu’il se servait de l’instant de désarroi qu’il provoquait pour pousser son avantage.
Pendant qu’il s’asseyait, j’ai frémi en pensant que pour venir jusqu’à moi, son élégante personne avait dû monter mon escalier douteux.
Mon bureau est installé dans une ruine célèbre, le quartier du Rôtillon. Dans la maison il n’y a que des artisans, céramistes, potiers, une tisserande, un photographe.
Le quartier est un des plus intéressants de Lausanne. Il a été très populaire, accroché à la pente derrière la colline de Bourg comme la misère s’accroche au dos des riches. C’est un des derniers témoignages de ce qu’était le Lausanne des petites gens. Il y a une trentaine d’années, on a commencé à se dire qu’on allait l’assainir.
Il s’agissait à l’époque de le vider de toutes les prostituées qui s’y étaient installées dans les années trente. J’ai encore vu les dernières, lorsque j’étais petite fille. Il me semble que c’étaient de vieilles femmes du peuple qui satisfaisaient les besoins des hommes les plus démunis. Je me souviens qu’elles étaient surtout dans une rangée de maisonnettes à un étage donnant sur la ruelle du Flon. Lorsque nous étions enfants, nous aimions à nous procurer des frissons en passant devant ces fenêtres à rideaux, vite, les yeux baissés. Ces dames nous poursuivaient de leur voix éraillée en nous intimant de rentrer chez notre maman et plus vite que ça.
Depuis des années, la bataille de la spéculation immobilière fait rage autour de ce pâté de maisons que l’on a laissé devenir vétuste. Presque plus personne n’y habite, notre maison est une des rares où il se passe encore quelque chose. Nous sommes d’ailleurs tous des expulsés en sursis. Nos baux – pour ceux d’entre nous qui en ont encore – sont renouvelables de trois mois en trois mois.
Vous comprendrez que j’aie pu ressentir une certaine émotion à voir assis dans ma maison presque en ruine, dans mon fauteuil de marché aux puces, un homme dont le complet valait à lui seul deux ou trois ans de loyer. Et que j’aie pu me demander ce qu’un homme si manifestement à son aise pouvait bien vouloir de quelqu’un qui vit, comme moi, à la bonne franquette.
«Que puis-je pour vous?» ai-je fini par demander.
«Audiblement, vous parlez anglais.»
«Audiblement. Alors?»
«Il paraît que vous excellez à retrouver les gens.»
«Qui vous l’a dit?»
«C’est ce que m’a assuré une femme que j’ai rencontrée hier soir à une réception. Son nom m’échappe, mais elle ne tarissait pas d’éloges. Vous auriez retrouvé sa fille adolescente, qui avait fugué.»
Il pouvait s’agir d’une demi-douzaine de mes ex-clientes. Il ne m’a pas laissé le temps de lui poser de questions.
«Il paraît que vous êtes quelqu’un qui trouve toujours ce qu’elle cherche.»
«Cela dépend. Qui avez-vous perdu?»
Il a ri.
«Qui vous dit que ce n’est pas un quoi plutôt qu’un qui?»
«Je ne vous connais pas, Monsieur Cromwell…»
«Carlyle.»
J’ai jeté un coup d’œil à sa carte de visite.
«Pardon, Monsieur Carlyle. Nous nous apprêtons à signer un contrat. Alors? Qui ou que voulez-vous retrouver?»
On a senti une légère hésitation. Je connais cet instant-là. Pour une affaire aussi sérieuse, peut-on vraiment faire confiance à une femme? Je ne souffre pas d’un complexe de persécution. Certains de mes bons clients m’ont avoué s’être posé la question, la première fois, au moment de se lancer à l’eau.
Une petite porte a fini par s’ouvrir au fond des yeux de Carlyle.
«J’aimerais que vous récupériez une créance. J’ai perdu mon débiteur. Il était pourtant chargé d’encaisser pour moi une somme très importante, qui m’est due depuis pas mal de temps.»
Et il m’a débité une histoire tellement complexe que je vous en fais grâce. Disons simplement que j’ai commencé par penser qu’en dépit de ses allures royales, ce type devait être un imbécile en affaires si vraiment, comme il le prétendait, il avait prêté de l’argent à quelqu’un qu’il ne connaissait que pour l’avoir rencontré une fois dans un hôtel, et qui s’était hâté de disparaître en ne laissant derrière lui qu’une fausse adresse et une reconnaissance de dette.
Lorsqu’il s’est tu, il a vu mon sourire, que je voulais aimable, mais qui devait être incrédule. Le superbe Thomas Carlyle me mentait. Je n’ai rien dit, mais mes pensées devaient se lire sur mon front hélas peu machiavélique. Il s’est redressé, prêt à se lever.
«Si vous continuez à vous moquer, je me casse.»
Il a dit «Je me casse, I’ll split», comme un vulgaire pékin en jeans, je suis devenue sérieuse d’un coup. Quelque chose me disait que je ne trouverais jamais l’argent qu’il cherchait, mais après tout pourquoi ne pas s’amuser un peu. Je n’étais pas suroccupée.
«Je vous prie de m’excuser. Je tâcherai de récupérer votre argent, si c’est humainement possible. Mais avec un débiteur dont vous ne connaissez pas l’adresse, pas la raison sociale, pas les tenants et aboutissants, permettez-moi de vous faire remarquer que ce ne sera pas simple, et que ce n’est pas garanti.»
Il m’a fixée un instant, puis, avec un haussement de sourcils:
«Parlons de vos honoraires. Combien?»
Le snob! Il me remettait à ma place. J’étais quelqu’un qu’il employait, rien de plus.
Il a sorti un carnet de chèques, et un stylo qui éclipsait la splendeur de son complet. J’ai frémi à l’idée que j’avais failli lui offrir mon briquet en toc.
J’aurais dû refuser ce travail.
Pour recouvrer des dettes, je suis championne olympique. Mais je n’arrivais pas à m’empêcher de penser qu’il avait dévalisé une banque, que ses complices avaient planqué le butin et qu’il voulait mettre la main dessus. Mon instinct tapotait à la porte de ma conscience. Laisse tomber, susurrait-il.
Quelque chose dans le regard de Carlyle m’a empêchée d’écouter la voix de la raison. J’ai plongé.
«Je vous donne une semaine. Cela vous coûtera quatre mille francs pour mon temps. Si je dois employer quelqu’un, voyager, ce sera en supplément. Cela peut doubler la somme.»
Sans sourciller, il a rempli un chèque de huit mille francs.
«À votre nom?»
«À mon nom.»
Il m’a tendu le feuillet bleu.
Je me suis levée, suis allée le poser sur le buvard de Sophie et lui ai dit des lèvres, sans émettre le moindre son:
«Allez encaisser.»
Elle a levé le pouce, souri, a repoussé sa chaise, mis le téléphone sur répondeur, empoigné son sac d’une main, le chèque de l’autre et s’en est allée.
Je suis retournée m’asseoir. J’ai sorti un contrat de mon tiroir, l’ai rempli, signé, le lui ai fait signer. Je lui ai donné l’original et j’ai rangé la copie.
«Voilà, Monsieur Carlyle. Maintenant vous êtes mon client. Vous êtes sûr de m’avoir tout dit?»
La sonnerie de ma ligne directe l’a dispensé de répondre.
«L’argent est à nous», a dit Sophie.
Depuis que je suis installée à mon compte, je suis toujours tiraillée entre deux sentiments: à la fois rassurée que quelqu’un m’ait donné du travail, ce qui me permettra de payer les factures, et angoissée à l’idée d’avoir trop à faire.
J’éprouvais tout cela en prenant congé de Thomas Carlyle, qui a encore lancé:
«Si par extraordinaire vous ne me trouviez pas, ne vous faites aucun souci. Je sais où vous joindre, moi.»
Cela ne m’a pas rassurée. Il avait à peine tourné les talons que j’appelais le Palace où il prétendait être descendu.
«Oui, Monsieur Carlyle est bien chez nous, mais il est sorti en ce moment.»
Au moins il existe, ai-je pensé.
J’ai passé deux jours à faire tout ce qu’on fait dans ces cas-là, sans trop de résultat. L’homme que j’étais censée chercher était insaisissable – peut-être inexistant.
Le troisième jour à midi, j’avais rendez-vous avec un de mes clients habituels, un banquier. J’avais dix minutes d’avance, je suis allée boire un café et me suis forcée à me concentrer sur les affaires dudit banquier. C’est là que je me suis rendu compte que je m’étais prise au jeu de l’«affaire Carlyle». J’ai dû faire un effort pour revenir au problème du moment. Dès que j’arrivais à y repenser, d’ailleurs, cela se remettait à m’agacer.
C’était une affaire tellement bidon qu’on se demandait comment une banque suisse aussi honorable et prudente avait pu prêter de l’argent à un hurluberlu de cet acabit. Depuis que je travaille pour ces boîtes-là, j’ai remarqué que leurs précautions vis-à-vis du petit emprunteur se double d’un étrange aveuglement face à des gens qui leur promettent de gros et rapides bénéfices.
Si vous voulez qu’une banque s’intéresse à vous, allez-y d’un bon mensonge bien organisé plutôt que de lui parler du développement d’une idée originale, et surtout n’empruntez jamais moins de dix millions. Parlez de recapitalisation, même si c’est une boîte pourrie que vous voulez «recapitaliser». Je vois cela tous les jours. L’enquête que je venais de terminer manquait tellement d’originalité que j’aurais pu faire le boulot sans quitter mon bureau. Par principe, je me déplace toujours, aussi la semaine précédente avais-je parcouru… non, je ne vais pas entrer dans les détails. Je n’ai pas récupéré le fric, je n’amenais aucun indice qui permette de le récupérer et, si vous voulez mon humble avis passez-le aux pertes et profits, vous vous êtes fait avoir comme un bleu par un beau parleur, voilà ce que j’ai dit à Claude Panchault, le directeur financier de la Banque de Crédit, qui s’est incliné:
«Si vous dites que c’est impossible, Madame Machiavelli, ce doit être vrai.»
Je simplifie un peu, parce qu’il a aussi parlé de la police, de porter plainte. Mais là, ce n’était plus mon affaire.
Lorsqu’on a terminé, il était midi, et il m’a offert un verre. Et je me suis aussitôt remise à penser à ma créance insaisissable. Ou serait-ce plutôt que je pensais à Carlyle?
À deux heures, j’ai fait un saut chez mon avocat qui, pour changer, n’était pas à son bureau. J’aurais pourtant bien aimé lui parler de mon affaire.
J’ai passé l’après-midi au téléphone avec Interpol, j’ai interrogé sur Internet des banques et des agents d’affaires dans le monde entier.
Vers quatre heures, Thomas Carlyle a appelé. Il venait aux nouvelles.
«Vous êtes sûr que votre débiteur existe?» ai-je demandé par acquit de conscience.
«Dites donc, pour qui me prenez-vous…?»
Le message implicite était: ma vieille, va te faire voir chez les Grecs. J’ai raccroché sans plus de commentaire.
Il fallait que je parle à mon avocat.
Mon avocat s’appelle Pierre-François. Sa mère l’a nommé ainsi parce qu’elle était cinéphile et qu’elle le destinait au barreau dès avant le berceau. Alors quand il est né elle a dit: il se tiendra toujours aux côtés des malfaiteurs, comme Pierre-François à côté de Lacenaire. Si vous n’êtes pas un connaisseur avisé des Enfants du Paradis, le film de Marcel Carné, sachez que Lacenaire était un bandit et un assassin célèbre, Pierre-François étant le bras droit que lui a adjoint Jacques Prévert, le scénariste, pour les besoins du cinéma. «Mon» Pierre-François a fait la carrière que sa maman lui souhaitait, à ceci près qu’il ne défend pas les malfaiteurs, mais conseille des gens dans mon genre.
Ce n’est pas du tout un avocat comme on se les imagine. On rit beaucoup, avec lui. J’ai fait sa connaissance dans une boîte de nuit où j’étais allée parce que je n’arrivais pas à m’endormir. J’avais un problème juridique à résoudre, et ce qui m’était resté (peu) de mes propres études de droit ne suffisait pas. Il me fallait un avocat. Un vrai. Je sirotais un whisky, l’œil fixe, quand l’orchestre s’est mis à jouer. On a vu sortir des coulisses un serpent superbe, moulé dans une robe en lamé et coiffé d’une perruque en pommier originel. Il a longuement et lascivement dansé, tenté quelques Adam et quelques Ève, fait rire tout le monde sauf moi. Je n’avais pas envie de m’amuser. Vers la fin de son numéro, il est venu s’asseoir près de moi et m’a demandé ce qui n’allait pas.
«J’ai un petit problème. Rien de grave.»
«C’est quoi, ce problème?»
«Dans la mesure où vous n’êtes pas un expert en droit fiscal, aucun intérêt pour moi de vous en parler, et aucun intérêt pour vous que je vous en parle.»
«Vous avez une chance de pendue, ma belle. Je suis avocat.»
Et il s’est remis à virevolter entre les tables.
À trois heures du matin il me donnait une consultation au coin du bar, le lendemain à l’aube j’étais chez mon client et en deux heures mon problème était résolu.
Là-dessus je n’ai pas hésité, j’ai confié mes affaires à Pierre-François. Et n’allez pas commettre l’erreur de ceux qui le connaissent mal et pensent que ce ne peut pas être un type sérieux parce qu’il danse dans les boîtes de nuit ou va travailler avec les forains pendant ses heures libres. C’est un expert redoutable en droit pénal – le droit fiscal n’est qu’un à-côté – quand il va plaider les procureurs rient jaune. Personne n’aime se mesurer à Maître Pierre-François Clair.
J’ai tenté de le joindre au téléphone, encore une fois. Toujours absent.
Pour en avoir le cœur net j’ai appelé, en fin d’après-midi, Jonathan Ryan à Scotland Yard. C’est un inspecteur serviable et sympathique, rencontré aux États-Unis pendant mon stage. Avait-il un Thomas Carlyle dans ses fichiers? Un nom pareil, ce devait être un faux, mais on ne savait jamais. Il a cherché pour moi, je l’entendais pianoter sur son ordinateur.
«Je ne vois rien dans le fichier des repris de justice, mais c’est normal», a-t-il fini par dire. «Si c’est un des Carlyle auxquels je pense, il sort d’une famille honorablement connue. Fortunée.»
«N’empêche que j’aimerais savoir si le Thomas Carlyle qui est venu me voir est vraiment un membre de cette honorable famille. Vous ne pourriez pas me procurer une photo?»
«Je vais voir ce que je peux faire.»
Avant de raccrocher, nous nous sommes promis, comme toujours depuis des années que nous nous connaissons, de nous revoir bientôt. Jusque-là, nous n’en avions jamais rien fait.
J’ai appelé le Palace. On était au regret de m’informer que Monsieur Carlyle était parti sans laisser d’adresse. Mais c’était un client régulier. On le reverrait, le Palace en était certain.
Au lieu de rentrer chez moi, je suis allée voir si Pierre-François était au bar du Carlton. Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Il y était. D’ailleurs à cette heure-là c’était pratiquement son adresse officielle. Comme il est mon avocat, je lui ai raconté toute l’affaire.
«J’ai envie de lui rendre le reste de son fric et d’arrêter», ai-je conclu.
«Tu as beaucoup à faire, en ce moment?»
«Non.»
«Alors attends quelques jours avant de baisser les bras. Il t’a payée, après tout.»
Le lendemain matin, l’inspecteur Ryan m’envoyait une photo par ligne. Pas de doute. Thomas Carlyle existait, et c’était vraiment la personne que je connaissais.
Quelques jours plus tard, je finissais par mettre la main sur son débiteur, un certain Henri Dumoulin, petit homme à la fois affairiste et apeuré qui n’avait opposé qu’une résistance pro forma avant de payer et que j’avais eu beaucoup de mal à associer avec le flambeur de grand hôtel dépeint par mon client.
Cela dit, j’ai vite oublié Thomas Carlyle. Son affaire est restée dans un coin de ma mémoire uniquement à cause du vague malaise qu’elle avait provoqué en moi pendant que je m’en occupais.
© Bernard Campiche éditeur, CH 1350 Orbe (Suisse)
«Ame de bronze» a été réalisé par Bernard Campiche avec la collaboration de René Belakovsky, Béatrice Berton, Marie-Claude Garnier, Marie-Claude Schoendorff et Daniela Spring. Photo de couverture: Laurent Cochet.
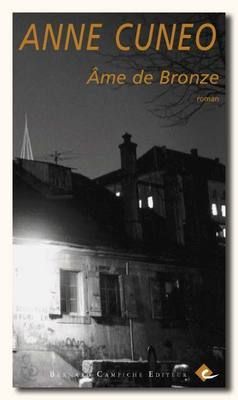
, le 24.08.2008 à 06:27
Je sens que je vais me régaler…
, le 24.08.2008 à 08:19
Bienvenus dans le monde de Marie Machiavelli, chers Amis. Pour répondre à la question qu’on ne pose souvent sur le feuilleton, et que j’ai déjà reçue une fois ce matin dans mon courrier électronique, si à un moment donné vous sentez le besoin de tenir du papier pour lire, vous pouvez commander Ame de Bronze chez Bernard Campiche éditeur . Vous allez sous Contacts, et pour 17€ il sera à vous rapidement. Tout comme il sera à vous (gratis) sur cet écran si vous avez la patience d’attendre…;~))
, le 24.08.2008 à 09:04
On pourrait éventuellement le commander de Belgique aussi ?
Okazou, moi je me régale déjà ;-)
, le 24.08.2008 à 09:21
Les commandes affluent depuis le monde entier ;-) On peut…
, le 24.08.2008 à 09:59
Quelle chance vous avez tous, de découvrir Marie Machiavelli. J’ai lu les quatre premiers volumes de ses aventures entre Noël et Nouvel An 2004, il me semble. Ce fut la meilleure trêve des confiseurs de ma vie.
À tous, beaucoup de plaisir. Et à Anne, d’immenses mercis pour tous ses livres. Cet été j’ai lu Zaïda. Six ou sept cents pages ; deux jours. Normal quoi !
, le 24.08.2008 à 10:11
wahou, intéressant ça semble au dessus de “la vermine”…Bon début…Merci Anne.
, le 24.08.2008 à 11:02
Biiiin, vivement dimanche prochain! selon la formule consacrée.
J’avais peur qu’un chapitre entier de lecture sur écran ne soit un peu longuet, à la fin, je me suis dit “déjà ?”
z (pas certain d’arriver à tenir le rythme hebdomadaire du feuilleton sur ce coup là, je répêêêêêêêête : un chapitre par jour, voire par heure, c’est jouable ?)
, le 24.08.2008 à 11:32
Heureusement, pourrait-on dire, la Vermine étant une oeuvre de prime jeunesse…
Mais, parfaitement… Tu achètes le livre et tu peux lire un chapitre toutes les dix minutes, si tu veux ;~))
, le 24.08.2008 à 11:39
Hehe, moi aussi il me semble que ça vas être super :D
, le 24.08.2008 à 13:05
Merci Anne:)
, le 24.08.2008 à 17:37
Deux jours pour lire Zaïda?
Moi il m’a fallu trois mois. En effet, je l’ai lu à raison de trois pages par jour environ, chaque soir, avant de dormir.
Ça a été une dégustation lente, j’ai adoré.
Un peu (beaucoup) triste quand il m’a fallu la quitter, arrivé à la dernière page.
Je suis très content que tu passes maintenant un roman relativement récent sur Cuk.
, le 25.08.2008 à 22:11
Après le maître de Garamond emprunté à la bibliothèque d’Auxerre, je suis pris par le trajet d’une rivière que me passe ma mère (et que je lui avais offert). Je vois des Anne Cuneo partout. Merci pour ce polar !